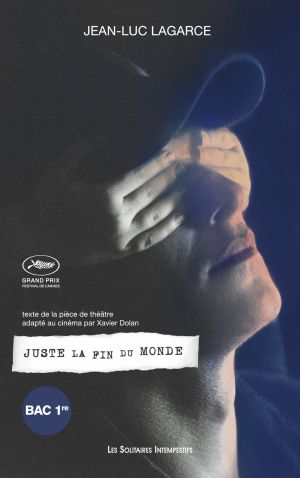

Juste la fin du monde
Louis, trente-quatre ans, est à l’aube de sa mort. Il a peur, mais il a décidé : il retournera voir sa famille. Après un très long silence ponctué de cartes postales, « petites lettres elliptiques », il parlera.
Lors d’une ultime visite, il annoncera sa mort prochaine à sa mère, à sa petite sœur Suzanne, et à son frère Antoine. À la discrète Catherine, la femme de celui-ci, il parlera aussi. Mais le retour inespéré du fils aîné dans « la maison de la mère » ranime d’anciennes querelles et de vieux fantômes de famille. Les mots s’empêtrent et les malentendus s’accumulent sous l’œil de la mère, car à la ville, « vous vivez d’une drôle de manière », dit-elle. Digressions, arrêts brusques, redites, la parole est en errance. Chacun tente de rattraper le temps perdu. Expression maladroite de la solitude, du doute, du manque, de l’envie, et de l’amour dissimulé sous un voile de rancœur. Finalement, Louis repart sans avoir pu se livrer, « sans jamais avoir osé faire tout ce mal », emportant à jamais son secret, comme si le silence était la seule issue.
L.S.-B.
Lagarce, inventeur d’une grammaire théâtre
Entretien avec Michel Raskine
L’état du monde et de la société, des mœurs ou de l’écriture contemporaine n’ont pas beaucoup changé entre la disparition de Jean-Luc Lagarce, en 1995, et la découverte réelle de son œuvre. Que nous soyons tous restés aveugles et sourds à cette écriture, de son vivant, à quelques notables exceptions près, reste pour moi un mystère, et une blessure. L’injustice est flagrante. L’entrée au répertoire de la Comédie-Française a quelque chose de solennel. C’est un geste fort de la part de Muriel Mayette. nous allons confronter la résistance de cette écriture « intimiste » à l’ampleur du lieu et de son histoire. La salle Richelieu résonne des voix de Racine, de Marivaux ou de Claudel. Jean-Luc Lagarce renouvelle la langue et le style, il appartient à la grande tradition française de l’écriture. Et comme Marivaux, Racine ou Claudel, il invente à la fois un théâtre à lire et un théâtre à faire. il s’inscrit dans la continuité des « inventeurs de langue dramatique ». La sienne est spécifique, elle oscille entre la parole quotidienne voire triviale, et un lyrisme revendiqué. C’est la langue de l’extrême écrit et de l’extrême oral, et il faut veiller à ce que les acteurs ne tombent jamais dans un excès ou dans un autre. nous ne devons ni « prosaïser » la langue, ni la déifier. il n’est pas question de se laisser aller à la « tentation de l’oratorio » : le théâtre doit incarner, rendre charnelle la parole des poètes. Et puis la langue et son interprétation sont deux formidables sujets d’étude et de plaisir. ici, l’écriture semble composée par vagues, mais nous sommes très loin du ressassement de Thomas Bernhard. il n’y a ni redite ni cette impression de spirale, mais une pensée en marche, qui « va devant », cela est éminemment théâtral. La parole s’inscrit dans un présent immédiat, la pensée arrive à la seconde où le mot est dit, et les personnages réajustent à chaque instant la pensée et le mot. ils modifient sans cesse le sentiment qu’ils ont du monde, des autres, d’eux-mêmes, et se contredisent parfois. C’est une langue extraordinairement composée, une partition en somme. Nous avons bien affaire à un quintet, avec parties chorales et parties solistes. nous travaillons à faire entendre à la fois la ligne musicale entière et chacune des notes et des nuances de cette pièce que je considère comme la plus belle et la plus essentielle de Lagarce.
Des personnes aux personnages, un écart infime
Sur le plateau, l’humanité doit apparaître. nous travaillons sans relâche à réduire l’écart qui sépare la personne qui joue du personnage qu’elle interprète. où est-il, ce très fragile ou bien cet immense écart entre ceux qui jouent et ceux qui sont joués ? nous connaissons ces personnages : ils sont nos mères, nos frères, nos sœurs. nous les reconnaissons parfois par fragments ou par- fois en bloc, et nous sommes infiniment proches d’eux tous. Voilà pourquoi je souhaite établir une réelle proximité entre les personnages et les acteurs, et donner d’emblée un sentiment de connivence et de reconnaissance avec les figures de Jean-Luc Lagarce. La proximité existera dès lors également entre les personnages et les spectateurs. notre travail s’inscrit dans ce lieu précis qu’est la salle Richelieu, armée de son histoire et de ses fantômes. Et nous avons avancé le plateau, nous jouons devant le rideau de scène. ils sont là, comme des frères, « frères humains qui après nous vivez… » L’immensité scénique peut devenir un ennemi, nous ne l’ignorons pas, et je voulais rapprocher Louis, Suzanne, Antoine, Catherine et la Mère de nous, physiquement. nous débarrassons la scénographie de toute imagerie anecdotique.
Le lieu du retour du fils est bien le théâtre : les retrouvailles des cinq personnages ont lieu sur la scène, cet espace unique, le théâtre, où même les morts peuvent venir prendre la parole.
L’élan de la réconciliation
La réconciliation est ici au cœur de l’histoire : Louis revient pour annoncer sa mort prochaine. Il est à la fois le héros de la pièce et le narrateur. C’est à la campagne, dans la maison de la Mère et de suzanne, mais nous sommes avant tout au théâtre. Louis nous parle, il est le conteur. impossible de nous installer dans un récit naturaliste, dans une reproduction du réel. Lagarce écrit une pièce où est incluse à chaque scène la question de la théâtralité et de la représentation. Les personnages de la pièce n’ignorent jamais que le public est dans la salle.
Louis nous annonce qu’il est mort : « Plus tard, l’année d’après, j’allais mourir à mon tour ». C’est la première phrase – saisissante – du texte. Et pour autant, Louis est dans le présent, vivant, il n’est pas encore une ombre. Juste la fin du monde évoque la mort inéluctable, celle du héros comme la nôtre. Et à l’inverse, la pièce porte un élan de vitalité, sans complaisance, sans mollesse : une énergie exceptionnelle et un formidable humour. Les dialogues et les échanges sont brutaux, crus, francs, mais la pièce n’est pas sombre. Les personnages ont un regard amusé sur le monde. ils ont une véritable capacité à rire d’eux-mêmes, tout en gardant une grande lucidité sur leur propre famille, sur les autres ou eux mêmes. ils ont une fantaisie, une ironie.
Toutes les familles sont des volcans
La famille nous constitue. on n’y échappe pas. on y est comme « condamné. » Est-ce le sort qui nous la donne, est-ce que nous nous la fabriquons ? La connivence est alors réelle, absolue, entre ces personnages et nous tous, puisque nous avons tous une famille. Au pire, nous en avons tous eu une. La famille est une entité non statique, un groupe en perpétuelle évolution. Aucune famille ne peut être tranquille. Toutes les familles sont des volcans. Les noyaux familiaux les plus harmonieux et les plus soudés traversent des épreuves, des crispations, des douleurs, des silences, des non-dits, des secrets, des tensions, des conflits, des drames, et des deuils… Dans la pièce Le Pays lointain, dont Juste la fin du monde est la matrice originelle, apparaît l’autre famille, celle inventée par Louis, sa famille d’adoption. Toutes les familles connaissent les variations qui vont du rejet à la réconciliation. L’abandon et le retour sont les deux thèmes primordiaux de l’œuvre de Lagarce.
En cela, Juste la fin du monde est bien « une pièce qui fait du chagrin ». Elle bouscule, bouleverse, elle atteint. Jean-Luc Lagarce nous livre la complexité formidable des rapports humains, et nous laisse sans réponse. Ce théâtre-là sollicite notre intelligence et notre émotion de la même manière.
La place perdue de l’enfance
Quelque chose relève du mystère insondable du théâtre, me semble-t-il, dans cette simple réplique de la Mère au Fils : « mais quel âge as-tu ? » Comment une mère peut-elle prononcer ces mots ? nous nous débrouillons avec une phrase comme celle-ci, et nous ne voulons pas tenter de la déchiffrer, de l’expliquer. nous l’entendrons prononcée dans une sorte d’impossible neutralité ! Quelle est la place que nous faisons aux uns et aux autres ? La pièce ne parle que de cela, de ce que nous sommes les uns pour les autres. Et la Mère, mystérieusement, ne sait plus l’âge de son fils. il s’agit là encore, probablement, de la place perdue de l’enfance. Juste la fin du monde fait ressurgir à chaque instant les mondes du conte. Des lambeaux d’enfance se cachent dans tous les recoins de cette pièce. Et l’on n’échappe pas plus à nos familles qu’à notre enfance.
Michel Raskine, janvier 2008
propos recueillis par Pierre notte, secrétaire général de la Comédie-Française
Source : Dossier Pièce (dé)montée à consulter sur Artcena
Vidéo - Journal télévisé
L'entrée au répertoire de la Comédie-Française de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, dans la mise en scène de Michel Raskine créée en 2008, est l'occasion de souligner la place accordée par cette institution nationale aux écritures contemporaines. Courts extraits du spectacle et interviews de Muriel Mayette, administrateur général, et de Laurent Stocker, sociétaire.
Voir la vidéo du 27 avril 2008 - 02m 04s
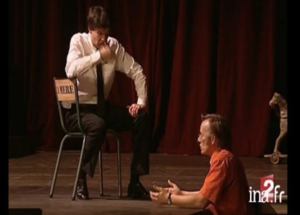
Podcasts
 France culturepar Je déballe ma bibliothèque
France culturepar Je déballe ma bibliothèqueLexture d'un extrait par Laurent Stocker...
Laurent Stocker a interprété Antoine dans la mise en scène de Michel Raskine.
Critiques
 Le Figaropar Armelle Héliot
Le Figaropar Armelle HéliotUn jeune homme revient vers les siens, sa mère, sa fratrie. Il les a quittés pour devenir lui-même. Mais peuvent-ils le comprendre ? Critique Reprise d'un spectacle qui a marqué l'entrée au répertoire...
Reprise d'un spectacle qui a marqué l'entrée au répertoire du regretté Jean-Luc Lagarce et qui, mis en scène par Michel Raskine et interprété par des comédiens remarquables, en tête desquels Catherine Ferran, restitue à merveille l'écriture douloureuse et pleine d'humour de l'auteur.
(abonnés) Toute la culturepar Christophe Candoni
Toute la culturepar Christophe CandoniUn drame intime et touchant
Il faut courir applaudir la reprise de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce à la Comédie-Française. La création de cette production en mars 2008 fut un immense succès et s’est distinguée en recevant le Molière du meilleur spectacle du théâtre subventionné. Un texte bouleversant qui parle de thèmes forts
 Le Mondepar Fabienne Darge
Le Mondepar Fabienne DargeLe spectacle idéal pour découvrir Jean-Luc Lagarce
Un soir de mars 2008, l'ombre d'un grand jeune homme maigre s'est glissée entre les ors et les rouges de la mythique salle Richelieu, à la Comédie-Française. Et ce qu'a vu ce soir-là le fantôme de Jean-Luc Lagarce (1957-1995) a dû lui faire plaisir : le succès incroyable de sa pièce Juste la fin du monde...
 Webtheatrepar Corinne Denailles
Webtheatrepar Corinne DenaillesPar la grande porte à la Comédie-Française
On ne peut que se réjouir devant le succès grandissant de l’œuvre de Jean-Luc Lagarce et l’impressionnante liste de mises en scène de ses pièces comme si on voulait se faire pardonner...
 Libérationpar Gérard Lefort
Libérationpar Gérard LefortCe que Lagarce veut dire
Juste la fin du monde est un texte sur la grammaire. Accords, conjugaison. Sur la langue française et ses folles aventures : logiques aberrantes, exceptions formidables, règles qui ne sont des règles que pour nous taper sur les doigts. Juste la fin du monde est une pièce de théâtre qui vient de rentrer au répertoire du Français. Et c'est naturel quoique considérable, puisque Jean-Luc Lagarce est un moderne classique...
Archives des représentations
-
Comédie-Française
|
Paris
01 mars 2008 > 03 janv. 2009







