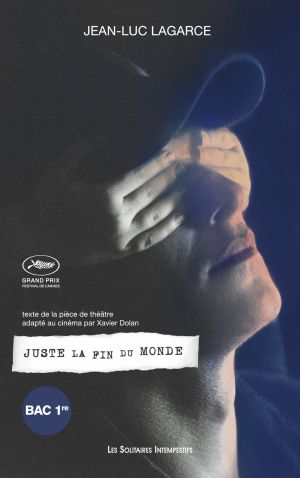
Extrait de la préface
Souvent un titre porte un secret, qui est celui de l’œuvre elle-même ; quelquefois ce secret est un message. Il peut même advenir que ce message s’avère intransmissible. C’est le cas de Juste la fin du monde dont le protagoniste, prénommé Louis, revient dans sa famille, après une très longue absence, afin d’annoncer sa mort prochaine, mais repart sans avoir rien dit à ses parents de l’issue fatale. Toute la pièce de Lagarce – l’un de ses textes les plus testamentaires, avec le Journal et Le Pays lointain – tient dans cet écart temporel entre l’intention d’annoncer la (mauvaise) nouvelle et l’impossibilité de le faire.
Louis. – […] je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage, […]
pour annoncer,
dire,
seulement dire,
ma mort prochaine et irrémédiable
l’annoncer moi-même, en être l’unique messager […].
Prologue
Louis. – […] vers la fin de la journée,
sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur […]
sans avoir jamais osé faire tout ce mal,
je repris la route […]
Deuxième partie, scène 1
Un mouvement contrarié, ce pourrait être la définition minimale de cette pièce et, peut-être, de tout le théâtre de Lagarce. Dans sa mégalomanie, l’individu-roi, artiste de surcroît, s’apprête à annoncer la fin du monde – en fait, de soi-même au monde – puis finit par s’avouer en son for intérieur, sur le mode dépressif, qu’il ne s’agit après tout que de cela : « juste la fin du monde ». Pas de quoi en faire une histoire. Ou, à la rigueur, une pièce de théâtre d’un type particulier : un drame qui n’advient pas, qui restera l’affaire intime d’un seul, en butte à l’impossibilité de se faire entendre – ou à celle de s’exprimer – dans son ultime confrontation avec les autres, mère, sœur, frère et belle-sœur, êtres chers et cependant définitivement éloignés. On ne s’étonnera pas que ce drame avorté, ce drame « à blanc » se déroule – ou se défasse – tout au long d’un dimanche, jour non ouvrable, jour de la vacuité, jour mythique des petites cérémonies domestiques et des sourds conflits familiaux.
*
Plusieurs des pièces de Jean-Luc Lagarce trouvent leur origine dans la parabole du Fils prodigue telle qu’on la trouve dans l’Évangile de Luc (XV, 23) : Retour à la citadelle et Les Orphelins (1984), Juste la fin du monde (1990), J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (1994), Le Pays lointain (1995). À l’instar de Gide qui imagine, dans une de ses fameuses soties, qu’une fois le Fils prodigue rentré à la maison et fêté, c’est au tour de son frère aîné de prendre la route, Lagarce imprime à la parabole originelle, dans chacune de ces pièces, d’importantes variations. Dans Juste la fin du monde, le père, décédé, n’est pas là pour accueillir Louis (c’est précisément sous la figure du « Père, mort déjà » qu’il fera sa réapparition dans Le Pays lointain, pièce ultime résultant d’une profonde réécriture de Juste la fin du monde). En outre, Louis n’est pas le cadet mais l’aîné des fils. Mais la principale distorsion se trouve ailleurs : dans le fait qu’au lieu de « revenir à la vie », comme il est dit chez Luc, le Fils prodigue de Jean-Luc est voué à une mort prochaine, une mort dont, une fois dans le cercle familial, il s’interdira d’annoncer la nouvelle. D’une certaine manière, Louis est un mort (« déjà ») qui revient parmi les vivants, et ceux-ci ne cessent de ressentir son étrangeté, sans pour autant savoir d’où elle procède. Peut-être même ont-ils fait de son vivant le deuil du Fils prodigue :
Louis. – […] Il y a dix jours,
j’étais dans mon lit et je me suis éveillé[…].
Je me réveillai avec l’idée étrange et désespérée et indestructible encore
qu’on m’aimait déjà vivant comme on voudrait m’aimer mort
sans pouvoir et savoir jamais rien me dire.
Première partie, scène 5
On pourrait aussi avancer le contraire : que Louis, malgré le mal qui le ronge, se considère comme le seul vivant face à cette assemblée des spectres familiaux. Mais ce serait méconnaître la tendresse infinie qu’il éprouve pour les membres de sa famille et oublier ce souci de ne pas leur « faire de mal » qui, au moins en partie, explique son renoncement à dire son attente d’une mort prochaine. Quoi qu’il en soit, il existe dans la pièce un profond décalage, fait d’une intimidation réciproque, entre celui qui revient et ceux qui l’accueillent. L’un est tout en retenue, les autres expriment tout au long de ce dimanche qui les réunit une dernière fois leur infinie perplexité à l’égard de celui qui les a désertés.
*
Mais ce qui démarque nettement Juste la fin du monde d’un drame de type psychologique, c’est l’inscription, dans la forme même de la pièce, de la partition entre deux espèces, deux castes de personnages. D’un côté, Louis, le nomade, à la fois personnage et narrateur d’une pièce qui s’écrit selon son point de vue, son regard, son écoute ; de l’autre, le quatuor des sédentaires – Suzanne, Antoine, Catherine et la Mère.
Dans l’ordre de la dramaturgie, Louis – qui sonne comme « Lui » – est l’héritier de toute une lignée de personnages déracinés : non seulement le Fils prodigue de la Bible, mais aussi Ahasvérus, le Juif errant, et Ismaël, le fils voué à l’exil qu’eut Abraham avec la servante Agar, le Jedermann ou l’Everyman des moralités du Moyen Âge et enfin, plus près de nous, l’Axel de Villiers de L’Isle-Adam, le Peer Gynt d’Ibsen, l’Inconnu du Chemin de Damas de Strindberg et tant de personnages du théâtre expressionniste allemand, qui, après s’être arrachés à leur milieu d’origine, ont couru éperdument au devant de leur destin solitaire et, le plus souvent, de la mort. Le Fils prodigue de la parabole reste un sédentaire avec un épisode de nomadisme. Louis, lui, s’est définitivement désarrimé de sa famille, de son lieu de naissance ; il pourrait reprendre à son compte la profession de foi de l’Inconnu du Chemin de Damas : « Je n’ai pas de maison, mais seulement un sac de voyage. »
Dramaturgie du bout du chemin de la vie : Louis restera pour l’éternité un personnage – ou un spectre – en mouvement, un marcheur, un mort debout, un mort qui marche.
Après sa courte halte dans la maison familiale, c’est d’ailleurs ainsi qu’il réapparaîtra furtivement, telle une créature de Giacometti, dans l’épilogue de la pièce : « et je marche seul dans la nuit, / à égale distance du ciel et de la terre ». Louis est au principe même du mouvement – contrarié – de la pièce. Et c’est à juste titre que François Berreur, dans sa mise en scène, et que son interprète, Hervé Pierre, en ont fait d’entrée de jeu un danseur, un funambule… Les quatre autres personnages forment, eux, un chœur désuni et, à leur corps défendant, un tribunal devant lequel le personnage errant vient comparaître, chacun témoignant de ce qu’il a représenté pour lui dans une sorte de déposition procédurale, ou encore d’oraison funèbre inconsciente prononcée face à un mort debout :
Antoine. – […] Tu ne disais rien.
Tu buvais ton café, tu devais boire un café
et tu avais mal au ventre parce que tu ne fumes pas et que les endroits comme celui-là, tôt le matin,
je le sais mieux que toi,
les endroits comme celui-là puent la fumée et donnent envie de dégueuler,
avec la fumée qui te descend dessus et te donne mal à la tête
et aux yeux.
Tu lisais le journal,
*tu dois être devenu ce genre d’hommes qui lisent les journaux, des journaux que je ne lis jamais […].
Première partie, scène 11
Le traditionnel microcosme dramatique se trouve brisé, séparé en deux parties inégales : d’un côté, Louis, personnage narrateur, messager potentiel de la nouvelle de sa propre mort ; de l’autre la famille, tout à la fois soudée et désunie par ses querelles ataviques que réveille le retour du Fils prodigue. Le quatuor familial représente la dimension statique de la pièce, dont toute la part dynamique est en quelque sorte contenue dans la démarche – ô combien compromise – de Louis. La pièce entière de Lagarce se présente ainsi comme un fragment : l’avant-dernière station d’un drame itinérant – Stationendrama, diraient les Allemands – dont Louis serait la figure centrale, mi-héroïque mi-grotesque : Fils prodigue confronté à l’aporie, à l’impasse tragique du retour. Du protagoniste de Juste la fin du monde – que l’on retrouvera dans Le Pays lointain, mais escorté de tout un monde extérieur à la famille : « Longue Date », « l’Amant, mort déjà », « un Garçon, tous les garçons », « le Guerrier, tous les guerriers »‚ « Hélène » – on pourrait dire qu’il arbore les traits, parfaitement oxymoriques, de l’étranger-familier. Fils prodigue qui, même de retour, ne cesse de porter avec lui et en lui ce « pays lointain » pour lequel, toujours selon l’Évangile de Luc, il a quitté sa famille et le lieu de ses origines. Si la reconnaissance (anagnorisis) représente d’après Aristote un des ressorts essentiels de la tragédie et, plus largement, de la forme dramatique dans son ensemble, la dramaturgie lagarcienne – et c’est précisément en cela qu’elle est moderne – met en scène une sorte de demi-reconnaissance ou de reconnaissance empêchée, de non-appartenance de Louis à sa propre famille. Exactement comme chez Pinter (Le Retour), chez Duras (La Musica), chez Fosse (Et jamais nous ne serons séparés), pièces dont les personnages – couples ou famille – sont à la fois très proches – jusqu’à la promiscuité – et très éloignés. Ou déjà, dans John Gabriel Borkman d’Ibsen, dont le protagoniste n’est reconnu par son épouse qu’une fois mort et littéralement statufié par le froid, mais surtout dans La Maison brûlée et La Sonate des spectres de Strindberg, où un père naturel renonce à se faire reconnaître par son enfant « naturel ».
*
Ce qui signe l’échec du personnage de Louis contribue paradoxalement à la réussite du dramaturge Lagarce. Mouvement contrarié, reconnaissance empêchée : la caractéristique de ces dramaturgies du retour, fondées sur la rétrospection, c’est de rester stériles au plan de l’action et de substituer au régime de l’enchaînement et de la progression dramatiques, celui de la déliaison et de la simple juxtaposition des parties. (...)
Extrait de la préface de Jean-Pierre Sarrazac







