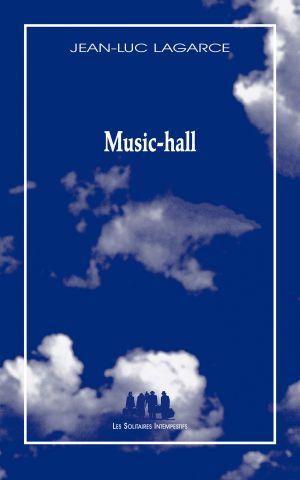

Music-hall
L’auteur, entré au répertoire de la Comédie-Française en 2008 avec ''Juste la fin du monde'', compose ici « un monologue à trois voix » pour la Fille, chanteuse à la jeunesse lointaine, nostalgique d’une époque qu’elle a rêvée ou vécue, et pour ses deux Boys, fidèles compagnons d’itinérance qui ont partagé les paillettes comme la noirceur de sa vie. Pour Glyslein Lefever, chorégraphe et metteuse en scène, ce music-hall est la métaphore d’un lieu de passage, de ville en ville, d’âge en âge, d’étape en étape. Un corridor. À l’écoute de cette partition rythmée, elle mise sur une scénographie où les effets de transparence et la magie de la lumière élargissent le sens de l’histoire, dont on ne sait finalement si elle se déroule dans un petit cabaret décati, une salle d’attente ou un couloir d’hôpital… La Fille rejoue sans cesse son entrée en scène – quête inépuisable de reconnaissance –, ses Boys se laissent emporter dans ce mouvement mémoriel et perpétuel, extrêmement poétique. Comme dans l’ensemble de son œuvre, c’est aussi Jean-Luc Lagarce qui se raconte à travers eux. Travaillant avec les acteurs la précision de la langue ciselée de l’auteur, la metteuse en scène cadence l’expressivité des corps, épuisés mais toujours animés d'un amour débordant de la scène, aspirant à l’ailleurs tout en étant profondément attachés aux feux, même brinquebalants, des projecteurs.
Entretien avec Glysleïn Lefever
Entretien réalisé par Laurent Muhleisen
Laurent Muhleisen. Comment vous est venue l’idée de monter Music-hall à la Comédie-Française ?
Glysleïn Lefever. C’est un projet que je portais depuis longtemps, et qui n’était pas, au départ, particulièrement destiné à la Comédie-Française. Pendant des années j’ai lu et relu ce texte, parmi d’autres de Jean-Luc Lagarce, que j’avais découvert au cours de mes études de théâtre dans les années 1990. L’envie d’en faire un spectacle est venue progressivement. Il y a trois saisons, au détour d’une conversation, alors que je travaillais dans la Maison, j’en ai parlé à Éric Ruf, qui m'a proposé de monter la pièce ici, au Studio-Théâtre.
Laurent Muhleisen. Dans la biographie qu’il a consacrée à Jean-Luc Lagarce, Jean-Pierre Thibaudat écrit au sujet de Music-hall : « La pièce oscille entre un léger vague à l’âme qui préfère en rire, une imputrescible tendresse pour le métier d’artiste et un goût pour ces moments qui ne racontent rien d’autre que leur vacuité…. Jouons quand même, et faisons semblant, et trichons jusqu’aux limites de la tricherie, l’oeil fixé sur ce trou noir où je sais qu’il n’y a personne, dit la fille… ». La pièce pourtant n’est pas uniquement teintée de nostalgie ?
Glysleïn Lefever. Non, pas du tout. Certes elle parle du vague à l’âme, de Jean-Luc Lagarce, de l’état dans lequel il se trouve constamment et qui est, je crois, ce qui le pousse à écrire. Cet « oeil fixé sur ce trou noir où je sais qu’il n’y a personne » est pour moi une métaphore de la mort, cette mort qui le guette depuis qu’il a appris, peu de temps avant de se mettre à l’écriture de cette pièce, qu’il était séropositif à une époque où le virus du sida avait une issue fatale pour quasiment toutes les personnes qui l’avait contracté.
Laurent Muhleisen. On ressent cependant fortement dans l’écriture de Jean-Luc Lagarce une certaine façon de mettre les choses à distance, de cultiver une sorte de « nostalgie du présent », et c’est le cas ici aussi, non ?
Glysleïn Lefever. C’est cela, justement, qui crée l’humour. C’est la distance qu’il met entre lui et les choses qui permet à Lagarce de traiter des sujets graves ; la distance et l’ironie.
Laurent Muhleisen. La pièce rend compte de l’immense tendresse que Lagarce, auteur et chef de troupe, éprouvait pour les acteurs, et son goût pour les tournées.
Glysleïn Lefever. On ne sait pas pourquoi, mais Music-hall a été écrite rapidement – cela n’était pas dans les habitudes de Lagarce – comme s’il avait une envie irrépressible de cette pièce, de cet état des lieux de sa vie, à ce moment-là. D’ailleurs, dans son Journal, à cette fameuse date du 23 juillet 1988 où il annonce qu’il est séropositif, il termine par cette phrase qui est très belle, et qui semble faire écho aux répliques de la Fille : « Sourire, faire le bel esprit. Et taire la menace de la mort – parce que tout de même… – comme le dernier sujet d’un dandysme désinvolte. » J’y perçois vraiment l’atmosphère de Music-hall : continuer, coûte que coûte, jusqu’au bout, l’air de rien. La pièce contient d’ailleurs d’autres d’éléments métaphoriques. D’abord, le tabouret – sur lequel Lagarce s’attarde, revient sans cesse… Ce tabouret – son théâtre ? – qu’il ne parvient pas à obtenir sur scène tel qu’il le rêve… Peut-être sert-il à exprimer son impuissance, sa difficulté à avancer en tant qu’artiste ; il ne faut pas oublier que ce n’est qu’après sa mort que son talent d’auteur sera vraiment reconnu. Ensuite, la robe, que je vois rouge, et qui pour moi symbolise à la fois la maladie et l’espoir, le « spectacle » envers et contre tout – contre la laideur du monde et les « goguenards ».
Laurent Muhleisen. Cette célébration du « spectacle » envers et contre tout, ne se manifeste-t-elle pas aussi dans le glamour qui auréole la Fille ? On connaît la fascination de Lagarce pour les grandes actrices, les actrices déchues. Cet aspect est-il important dans votre travail avec Françoise Gillard, mais aussi avec Gaël Kamilindi et Yoann Gasiorowski ?
Glysleïn Lefever. Il n’est pas question pour moi de développer le côté « cabaret triste, glauque », de province, un peu miteux. Au contraire, je veux rendre les trois protagonistes encore plus beaux qu’ils ne le sont. Ce n’est pas une question de plumes ou de paillettes – j’aimerais qu’ils soient beaux comme des fantasmes. Ils incarnent pour moi le fantasme de Jean-Luc Lagarce : ils sont lui, ses amis, ses amants, toutes les personnes qui l’ont entouré et accompagné (au milieu de sa solitude), portés par la voix de la Fille, qui reflète sa voix intérieure, une voix très profonde, comme enfouie. Parfois, on a l’impression que la Fille rêve ce qui lui arrive sur scène, et parfois, qu’elle est extrêmement « réelle ». Les deux côtés de ce miroir fonctionnent, dramaturgiquement.
Laurent Muhleisen. La beauté des personnages se reflète également dans leurs échanges…
Glysleïn Lefever. Oui, dans leur complicité, leur prévenance, leur douceur. Les deux Boys sont là, avec leur côté sculptural, pour aider la Fille à « passer ». Il y a de ce point de vue, dans la mise en scène, tout un travail à faire sur le corps. Pour revenir à cette solitude, je crois que Lagarce avait besoin de l’éprouver, de la cultiver, pour alimenter cette mélancolie, mais aussi une forme de mystère dont il voulait s’auréoler. Sans doute y a-t-il quelque chose de masochiste dans les rapports qu’il entretenait avec ses proches. Dans Music-hall, il crée ce trio très protecteur, une sorte de combinaison idéale, qui permet à la fille d’être admirée, de briller, de faire son entrée comme une diva. Derrière la Fille, je vois Jean-Luc Lagarce. Nous travaillons également beaucoup cet aspect-là : le besoin de Lagarce d’être désiré, admiré. Un besoin d’artiste. Se faire désirer et désirer, pour pouvoir créer.
Laurent Muhleisen. Le Studio-Théâtre n’est-il pas un peu l’espace rêvé pour faire cette mise en scène ?
Glysleïn Lefever. Totalement. Cet espace est parfait. Il est confiné (avec tout ce que l’emploi de ce mot peut avoir d’ambigu en ce moment), et donne l’impression qu’on est dans un cocon, dans de la ouate. Malgré le peu de profondeur, il me permet tout de même de travailler l’arrivée « au lointain » de la Fille, en diagonale, par une série de plans successifs, qui peuvent suggérer l’idée de ce tunnel à l’issue fatale – issue qu’on ne verra pas…
J’avais envie, pour le décor, d’une sorte de corridor, de salle d’attente, d’un espace en entonnoir, dont la fonction n’est pas clairement définie ; il est possible qu’on y soit, mais aussi qu’on n’y soit pas. On est sur une scène de théâtre, il n’y a donc selon moi rien d’autre à montrer que le fait qu’on soit dans un théâtre.
Il y a plusieurs niveaux de lecture dans Music-hall. Et j’avais également besoin que le décor reflète ces différentes strates dans lesquelles nous pourrons naviguer, du fantasme à la réalité, dedans-dehors, hier-maintenant… Un cabaret des âmes perdues. Un no man’s land cotonneux. Un refuge pour se livrer.
Laurent Muhleisen. Si Music-hall n’est pas une pièce sur le music-hall, elle n’en est pas moins extrêmement musicale, par la ritournelle de la chanson de Joséphine Baker, mais aussi dans son écriture. Qu’est-ce que cette musicalité a éveillé chez la chorégraphe que vous êtes également ?
Glysleïn Lefever. Lagarce écrit un théâtre du dire, de la parole, et c’est celle-ci qu’on peut, qu’on doit, à mon avis, chorégraphier. Le corps ne peut qu’être vecteur de cette parole, si bien que pour moi, tout doit être très clair dans ce qu’il exprime chez les acteurs. Je souhaite me servir de ces corps pour porter la parole en respectant le rythme, la partition extrêmement ciselée du texte. Cela demande un travail très minutieux, d’une grande dimension esthétique. À certains moments, le texte peut prendre plusieurs couleurs, et le corps doit rendre compte de cela. De la façon la moins naturaliste possible. Comme je le disais plus haut, il y a du fantasme et de la réalité dans la pièce.
En ce qui concerne la musique, le choix, répétitif de cette chanson de Joséphine Baker reste une énigme. Les moments où elle résonne sont signalés avec précision, et je les respecterai presque à la lettre, parce qu’ils témoignent d’une évolution. Cela ne m’empêchera pas d’avoir, ailleurs, d’autres épisodes musicaux ou dansés, qui n’auront rien à voir avec ce leitmotiv. Il s’agira d’un habillage musical, que j’ai souhaité confier à Sylvain Jacques, qui donnera un souffle, une tonalité, du relief à tous ces non-dits du texte, parfois abrupts, tendus, tout en gommant un peu l’angoisse du vide, à l’image de cette petite musique qui surgit parfois en nous quand nous pensons à la mort.
Bien sûr, on peut comprendre les paroles de la chanson : « Ne me dis pas que tu m’adores, mais pense à moi de temps en temps », comme une sorte d’injonction que Lagarce souhaite faire aux gens qu’il a aimé et qui l’ont aimé, une fois qu’il sera mort. Et puis, Joséphine Baker est une icône glamour, elle symbolise la femme indépendante, libre, adulée par les gays, et la pièce rend aussi compte de cela, un peu. Elle a ce parfum des amours libres (car le triangle amoureux, dans la pièce, peut très bien fonctionner dans tous les sens), dans ces années de lutte d’émancipation des homosexuels, en pleine tragédie du sida. En cela, elle est un hymne à la liberté.
Hymne qui résonne pour moi considérablement en 2021. Cette pièce de Lagarce est brûlante d’actualité. Pour mémoire, il l’a écrite dans une situation de découverte d’une pandémie (le sida), engendrant l’angoisse de la contagion, la considération – ou le manque de considération – pour les personnes atteintes. À cela s’ajoute le contexte des attentats de Saint-Michel, installant la peur du terrorisme. Ces inquiétudes sont de nouveau très/trop présentes dans notre quotidien. Quant à sa quête de la place de l’artiste, qui est le coeur de Music-hall, nous espérons pouvoir y répondre dès que nous pourrons lever le rideau…
Entretien réalisé par Laurent Muhleisen. Conseiller littéraire de la Comédie-Française, février 2021
Critiques
 Publik Artpar Amaury Jacquet
Publik Artpar Amaury JacquetAu Français, un “Music-hall” qui swingue sous la parole intranquille de Lagarce
Une fille, chanteuse de music-hall un peu fêlée et ses deux acolytes, qui pour la énième fois, s’apprêtent (à priori), à entrer en scène en ressassant leurs vies … Mais qui sait ? peut-être répètent-ils inlassablement leur entrée en scène, en (ré) inventant leurs vies...
 Les Inrockspar Igor Hansen-Løve
Les Inrockspar Igor Hansen-Løve“Music-Hall” à la Comédie-Française, la vie rêvée d’artiste
Trois comédien·nes déclinant·es évoquent les joies et désillusions de leur métier d’amuseur·euses. Glysleïn Lefever accentue l’étrangeté de cette pièce de Jean-Luc Lagarce, en optant pour un traitement lynchien qui entortille les sens. Une réussite...
 Un fauteuil pour l'orchestrepar Denis Sanglard
Un fauteuil pour l'orchestrepar Denis SanglardComme tous les soirs, la même histoire
Elle est là, comme tous les soirs. A raconter sur son tabouret, important le tabouret, son histoire. Son Music-Hall. Cette tournée qui s’étiole et n’en finit pas de mourir, de théâtres en cabarets, dans l’indifférence d’un public de plus en plus rare. Avec ce même rituel, cette entrée lente et désinvolte, du fond du plateau, accompagnée de ces deux boys. Ces deux-là qui furent sans doute ses amants...
 Scenewebpar Vincent Bouquet
Scenewebpar Vincent BouquetAu Studio-Théâtre, un vénéneux Music-hall
Dans le petit monde de Music-hall, La Fille a des airs de Sisyphe. Tel le fondateur de Corinthe poussant éternellement son rocher, elle remet, chaque soir, son art sur le métier, de lieu en lieu, de ville en ville. On devine bien vite que la revue qu’elle mène n’a plus son lustre d’antan – mais l’a-t-elle déjà eu ? –, que les spectateurs sont de moins en moins nombreux, que les salles sont de plus en plus miteuses, à l’image de celle de Montargis, « le trou du cul du cul de la fin du monde », écrit Lagarce...
 Les Échospar Philippe Chevilley
Les Échospar Philippe Chevilley« Music-hall » au Français : dans un paradis blanc
La metteuse en scène et chorégraphe Glysleïn Lefever orchestre avec élégance la pièce joyeusement funèbre de Jean-Luc Lagarce. Le trio formé par Françoise Gillard, Gaël Kamilindi et Yoann Gasiorowski brille par sa grâce et sa sensualité. Un rendez-vous à ne pas manquer au Studio de la Comédie-Française.
Archives des représentations
-
Comédie-Française
|
Paris
02 juin 2021 > 09 janv. 2022







