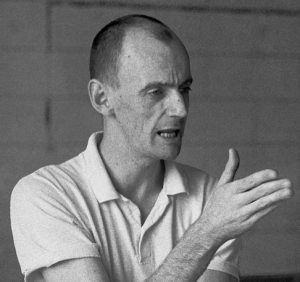
Questions de Lagarce
Par Joël July & Laure Himy-Pieri
Résumé :
La recherche d’un langage « naturel » au théâtre, qui serait le reflet des conversations, donne aux phrases interrogatives un rôle privilégié. On s’aperçoit pourtant que chez Lagarce, les questions sont moins des interrogations en appelant à l’autre que des salves verbales empêchant toute réponse, des incidentes liées à des phénomènes d’hypercorrection, des formules proches de la dénégation. À moins que la parole ne soit en fait monologue, voire soliloque ; et la question alors fait partie de l’ensemble des procédés de détour et retour familiers au XXe siècle pour approcher l’expression juste, pour saisir la parole intérieure. L’ensemble de ces dysfonctionnements ne laisse sauves que les questions rituelles, seules aptes à permettre une forme d’échange, valorisant dans le texte lagarcien une forme de platitude considérée comme realia.
Première pages
Il semble difficile de poser la question du réalisme indépendamment de l’appartenance générique des textes qui peuvent servir de terrain à son étude. La notion de représentation est en effet tout particulièrement exhibée au théâtre : le texte est porté par un acteur qui le joue, et la question du jeu, de son caractère hiératique, mimétique, « surjoué », est évidemment centrale dans la relation au spectateur. Très tôt donc, la question du réalisme sera doublée au théâtre par celle du « naturel ». Certes, l’intrigue peut comporter des éléments factuels, d’ordre socio-historique, dont le poids référentiel sera le garant d’une forme de « réalisme ». Mais toutes les querelles qui feront l’évolution du théâtre portent moins sur l’intrigue que sur la typologie du personnel théâtral, et sur sa langue.
Que l’on parle de Corneille, de Diderot, ou de Hugo, tous ces dramaturges critiquent l’esthétique dont ils héritent au nom d’une forme de vraisemblance nouvellement conçue, dont la légitimité relève non des règles, mais d’un public auquel il est fait appel – quitte d’ailleurs à le créer par cet appel –, et qui par sa reconnaissance, garantit la qualité de la pièce. Mais reconnaissance est alors à prendre aussi au sens strict : il s’agit
bien de faire des pièces dans lesquelles ce qui est représenté entretient un rapport de coïncidence avec la conscience du spectateur, il s’agit bien que le spectateur entende quelque chose de sa façon de parler, de sa vie, de son rapport au monde. En ce sens, la question du dialogue au théâtre croise celle de la capacité qu’aurait ce genre à prendre en charge la reproduction d’une conversation. Entre genre littéraire – dans lequel le bien-écrire intervient donc de façon variable selon les époques – et pratique vivante – dans laquelle la présence corporelle des acteurs, la question de la diction, de la prononciation, la question du jeu et de l’identification ou de la distance de l’acteur vis-à-vis du personnage, modifient considérablement les problématiques strictement textuelles –, le théâtre demande sans doute une approche particulière de la question
de « réalisme(s) et réalité(s) ».
C’est à travers le problème spécifique de l’interrogation que nous avons choisi d’aborder cette réflexion sur le théâtre de Lagarce, en privilégiant deux pièces : Derniers remords avant l’oubli et Juste la fin du monde.
L’interrogation est en effet un élément central dans le fonctionnement du théâtre, puisqu’elle a une vocation toute particulière à assurer progression du dialogue et enchaînements, en même temps que, dans la spécificité d’une écriture du XX e siècle, elle se fait le relais du bégaiement qui traverse tant les pièces de Lagarce que celles de bien des auteurs de l’époque. C’est lorsque les personnages s’interrogent (réfléchi et réciproque) que le spectateur / lecteur peut avoir l’impression d’un disque de la conscience rayé, qui bute sur des tournures dont la régularité répétitive, plus que le contenu, vaut expressivité. À l’époque où il écrit, Lagarce reprend après bien d’autres, la question de la possibilité et de la nécessité de dire ; après bien d’autres, il bute sur les difficultés de la parole : la construction lacunaire de bien des interrogations viendrait imiter la parole induite et à demi achevée, entre reproduction littéraire de la conversation naturelle et représentation littéraire encore de l’effort de la conscience pour saisir ce qui lui échappe.
Joël July, Laure Himy-Pieri. Questions de Lagarce. Questions de style , 2012, Réalisme(s) et réalité(s), 9, pp.93-108. ⟨hal-01675810v2⟩







