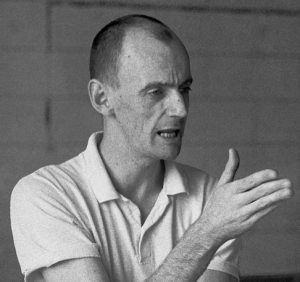
Lagarce et les révolutions
Par Lydie Parisse
Résumé :
Entre enchantement et désenchantement, tendresse et ironie, Lagarce distille dans ses textes de fiction et dans son journal son humour corrosif et désespéré. Il aborde le thème des révolutions avec un regard à la fois proche et distancié. Proche, lorsqu’il évoque, aux yeux de sa génération perdue et aux yeux des plus jeunes, les enthousiasmes révolutionnaires éprouvés par les aînés qui ont eu vingt ans en 1968. Distancié, lorsqu’il peint des révolutions plus lointaines, dans l’espace et dans le temps, cultivant l’anachronisme, voire l’onirisme, se rattachant à la fois à son enracinement profond dans le milieu ouvrier et à la tradition des moralistes au regard sans concession sur la nature humaine, faisant de ce regard sans concession la condition même du comique et de l’acte théâtral.
Les pièces testamentaires du cycle du fils prodigue (Le Pays lointain, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, Juste la fin du monde) de Jean-Luc Lagarce sont à la fois traversées par une parole transpersonnelle et un propos transhistorique. Les personnages de Lagarce s’y expriment en effet au nom d’un « nous », affirmant une « identité générationnelle », celle des années de l’après-guerre froide. Lagarce (1957-1995) y revendique une identité collective, se faisant le porte-parole de toute une génération née à la fin du baby boom et pendant la guerre d’Algérie. Or, la pièce Les Solitaires intempestifs, placée sous le signe de Par les Villages de Peter Handke, devait s’appeler 57/87, pour évoquer une génération sacrifiée, née trop tôt ou trop tard (comme les Romantiques), trop jeune en tous cas pour avoir pu participer aux événements de 1968. Dans Derniers Remords avant l’oubli, proche, dans son dispositif, du film Nous nous sommes tant aimés d’Ettore Scola, Lise, la jeune étudiante qui se destine aux métiers de la communication, reprend cette analyse générationnelle pour dresser un portrait désenchanté de ses parents en ex-
soixanthuitards attardés.
Enfin, la pièce Noce, exprime, avec un humour décapant, le malaise d’une société en quête d’un élan collectif, brisée par l’individualisme féroce et le mercantilisme à outrance. Ce texte met en scène un combat pour une vie meilleure, incarné par des convives de seconde ou troisième zone qui cherchent à participer, sans y être invités, à une noce réservée à des nantis.
Or, à travers le langage de ces figures de révolutionnaires anonymes, les révolutions se superposent : celle de 1917, celle de 1789 et bien d’autres. L’approche de Lagarce se veut européenne : l’influence de Ionesco, de Kafka et de Handke est marquante dans son œuvre et dans son journal vidéo, œuvre testamentaire, où il tisse son histoire personnelle à celle de la chute du mur de Berlin, ville où il est en résidence à la Villa Médicis en 1989 : pendant tout le film, on entend des bruitages d’éboulements.
1. Une parole transpersonnelle
Une génération perdue
Les Solitaires Intempestifs, avant de devenir le nom de la célèbre maison d’édition fondée par François Berreur en 1998, est le titre d'un collage réalisé par Jean-Luc Lagarce en 1987 qui portait le titre initial de 1957-1987 avec le sous-titre Et comble d'injustice, les jeunes gens d'aujourd'hui sont plus beaux que nous ne l'étions. Ce n'est qu'en 1992 que Jean-Luc Lagarce trouva les moyens financiers de réaliser ce spectacle. L'idée "d'avoir trente ans" avait disparu – Jean-Luc Lagarce, né en 1957 est mort du Sida en 1995 à l’âge de 38 ans. Il avait onze ans en 1968, il a connu les Trente-Glorieuses, l’épidémie du Sida, la mort des grandes figures telles que celles de Samuel Beckett, Andy Warhol, Thomas Bernard, Bernard-Marie Koltès, il a connu la montée des fascismes en Europe et du Front National en France, dont il suit pas à pas les progrès dans son journal. Lagarce est de la génération de ceux qui ont reproché à leur parents leur quête du confort matériel, leur perte d’idéaux, et qui se sont jurés de ne pas pactiser, mais qui sombrent dans le confort petit-bourgeois, et s’en veulent.
« Nous avons trente ans.
Nous croisons parfois quelques gamins qui nous disent : « de ton temps… »
Nous sommes nés à la fin de la Guerre Froide, nos parents ont l’âge de Brigitte Bardot, Johny Hallyday et Pierrot le Fou.
Ils auraient l’âge de Jean Seberg si elle avait voulu.
Nous sommes les petits frères des fameux enfants de Marx et de Coca-Cola et nos écoles sont restées fermées pendant le mois de mai 1968.
Nous sommes devenus sans nous en rendre compte les aînés de la Génération morale.
Nous faisons l’amour en pensant à la Mort et nous sommes inquiets de la Paix.
Nous sommes Fabrice à Austerlitz : nous ne voyons rien des batailles et des réalités du monde.
Nous sommes amusés de notre propre nostalgie. Nous sommes nourris de nos livres et des livres de ceux qui nous précédèrent.
Nous aimons les chansons qui nous parlent de chansons et les films qui nous parlent de cinéma.
Nous marchons paisiblement dans la peur et la beauté des catastrophes ou des utopies les plus
terribles.
Nous ne sommes faits que des souvenirs qu’on nous inculqua.
Nous ne sommes pas des références ».
Dans ce manifeste, Lagarce évoque à mots couverts les années Sida, et exprime sa croyance en la force de l’art. Il aurait pu ajouter : « nous aimons les spectacles qui nous parlent de théâtre ». Issu d’un milieu ouvrier dans l’Est de la France, près de Montbéliard, entre les usines Peugeot à Sochaux et Alsthom à Belfort, il a toujours défendu une certaine idée de l’engagement artistique, comme lors d’une présentation de saison en 1995 au théâtre de la Métaphore à Lille, où il explique que défendre le luxe que représente le théâtre quand l’on est issu d’un milieu défavorisé exposé au chômage n’allait pas de soi. Le théâtre est toujours présent, comme thème, dans ses pièces, qui sont des formes métathéâtrales. Le spectateur,
quand il pénètre dans une salle de théâtre, doit assumer, selon lui, cette convention selon laquelle ce qu’il va voir a déjà été répété.
Son ironie persistante n’épargne aucune génération, y compris la sienne. Il n’épargne pas les générations précédentes, ni celles qui suivent, dans une pièce qui a pour titre Derniers remords avant l’oubli (1987), et présente les années 1968 vues à travers la génération des
années 1990.
Source :
Lydie Parisse. Lagarce et les révolutions. L’événement révolutionnaire et ses figures emblématiques dans les littératures européennes : regards croisés, F. Bercegol, J.-Y. Laurichesse, P. Marot, Apr 2018, Toulouse, France. pp.113-122. ⟨hal-04758469⟩







