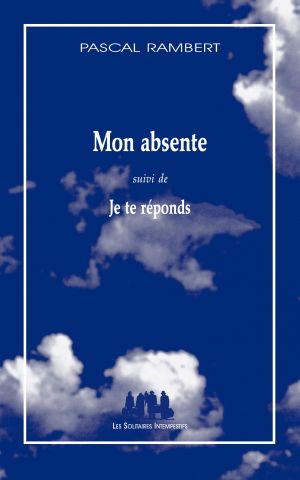

Mon absente
L’auteur et metteur en scène Pascal Rambert écrit spécialement pour les six actrices et cinq acteurs qu’il réunit ici sur scène. Mon absente est une pièce chorale, où des personnages sont rassemblés par la perte d’un être cher. Dans un espace plongé dans le noir, aux limites indistinctes, surgissent des corps, des mots. Dix personnes sont là pour s’adresser à l’absente. Quels liens existent, à la fois entre elles et avec cette absente ? Au travers de leurs souvenirs, des paroles échangées, de l’évocation de moments poignants ou infimes, une vie se recompose. Dans ce travail de mémoire, où jaillissent des contradictions, des interprétations et réécritures, se dessinent aussi les portraits des êtres en présence. Le souvenir est vivant et agissant, force de projection.
Note d’intention par Pascal Rambert
Mon absente plonge le spectateur au cœur d’un lieu clos, calme et profond, en marge de la vie qui court et oublie ce qui la fait courir. Une communauté d’endeuillés, famille et amis mélangés, se retrouve au chevet d’une femme qui n’est plus là. Et les souvenirs affluent. Et les langues et les larmes se délient. Un portrait diffracté se détache du vide laissé.
Née d’une commande pour les acteurs et actrices associés du TNS, Mon absente a pris sa source dans la béance du décès de Véronique Nordey. Mais le projet s’est petit à petit transformé et c’est une figure fictionnelle qui tient désormais lieu d’absente et de lien entre les personnages en jeu. À la distribution initiale s’est ajouté un nouveau cortège, quelques élèves fraichement sortis du TNS et présents sur Mont Vérité ainsi que Mata Gabin. Ils sont maintenant 11 présents, hommes et femmes de diverses origines et générations, à confronter la verticalité de leur corps et la chaleur de leur souffle à l’épreuve de la disparition, au mystère de la mort. À la déflagration de la perte. Réunis par le deuil, ils gravitent en satellites autour d’un cercueil jonché de fleurs, point fixe autour duquel s’organise leur ballet d’entrées et de sorties. Dans ce décor de douleur et de recueillement, la parole maintient en vie, fait tenir, ensemble, pour le meilleur et pour le pire, les vivants.
Entretien avec Pascal Rambert
Peux-tu parler de l’origine de la pièce Mon absente ?
Pascal Rambert : L’idée de Mon absente est née d’une discussion avec Stanislas Nordey. J’allais quitter Avignon après les représentations d’Architecture dans la Cour d’Honneur, en 2019 ; je partais pour Lima où j’allais préparer la version péruvienne de Sœurs. Stanislas me dit : « J’aimerais que tu écrives pour les actrices et acteurs associés du TNS ». J’ai trouvé cette idée enthousiasmante.
Quand les voyages en avion sont longs, c’est l’occasion pour moi de rêvasser pendant plusieurs heures ; j’ai pensé aux actrices et acteurs associés du TNS et une personne manquait cruellement : Véronique Nordey. J’avais toujours eu très envie de travailler avec elle, mais cela ne s’était pas fait. En descendant de l’avion, j’avais trouvé le titre : Mon absente.
Après Lima, je passais par le Mexique, pour préparer la création de DESAPARECER : l’histoire d’un jeune homme, cinéaste, qui disparaît dans le désert de Sonora au Mexique et dont toute la famille recompose, peu ou prou, l’existence, au travers des souvenirs. Je me suis dit que j’allais aussi, dans Mon absente, travailler sur la disparition et le souvenir – ce qui signifie donner un visage à l’absence. Lorsqu’une personne disparaît, il y a toujours l’espace du souvenir qui s’ouvre, le désir de reconstituer les moments passés ensemble, les paroles échangées… C’est ce dont il est question ici.
Mon père est mort il y a deux ans et demi. Il avait 93 ans, il est parti un après-midi, alors qu’il taillait son citronnier dans le jardin, l’été – une superbe fin, très tranquille.
Quand je suis venu pour le voir avant la fermeture du cercueil, je lui ai glissé un petit mot à l’intérieur de sa veste. C’est ce geste que je souhaite « déplier », déployer avec les actrices et acteurs. Je reconstitue un portrait à la fois de ceux qui parlent et, à travers eux, de la personne disparue.
Ton impulsion première était liée à l’absence de Véronique Nordey. Comment les choses ont-elles évolué depuis ?
P. R. : Le temps a passé et je me suis distancié de ce point de départ. Dans la pièce, il n’est pas question de la vie de Véronique, ni de celle de Stanislas Nordey – encore moins du rapport entre eux. D’ailleurs, je n’écris jamais sur la vie personnelle des acteurs. Une chose est restée : le lien à l’Afrique. Le père de Véronique – le grand-père de Stanislas – était noir. Ces dernières années, je suis allé plusieurs fois en Afrique – surtout au Burkina Faso. Je n’y étais pas allé auparavant car je travaillais beaucoup sur d’autres territoires dans le monde. L’Afrique est entrée dans mon travail et sa présence s’affirme dans Mon absente.
Les interprètes sont vraiment le ciment de ton théâtre car tu écris spécifiquement pour chaque personne. Peux-tu parler de la distribution ?
P. R. : J’écris pour la première fois pour Laurent Sauvage, Vincent Dissez et Claude Duparfait. Je les ai vu jouer dans beaucoup de spectacles et je me réjouis de pouvoir travailler avec eux. Je retrouve Stanislas Nordey et Audrey Bonnet, avec qui j’ai une longue histoire.
Je voulais retravailler avec des actrices rencontrées lors de Mont Vérité [spectacle d’entrée dans la vie professionnelle du Groupe 44 de l’École du TNS] : Océane Caïraty, Mélody Pini, Claire Toubin et Ysanis Padonou. Depuis, Houédo Dieu-Donné Parfait Dossa, qui faisait aussi partie de l’aventure Mont Vérité, nous a rejoints. Je suis très heureux de les retrouver. Je n’ai jamais travaillé avec Mata Gabin mais elle a joué Dans la solitude des champs de coton avec Charles Berling et était formidable. Quand je l’ai rencontrée pour lui parler du projet, j’ai découvert qu’elle a été l’élève de Véronique Nordey et a été marquée par son enseignement. Une incroyable coïncidence ! Elle a été touchée quand je lui ai parlé de l’origine du projet – même si, aujourd’hui, le personnage de l’absente n’a plus rien à voir avec Véronique. Je suis ravi de travailler avec cette belle actrice qui a traversé l’écriture de Koltès.
Dans Mon absente, il y a justement des souvenirs d’état de guerre en Afrique. Fais-tu référence à un événement particulier ?
P. R. : Malheureusement, je n’ai pas pensé à un événement précis mais à ce qui est récurrent au sud du Mali, au nord et à l’ouest du Burkina Faso : des groupes djihadistes s’attaquent régulièrement aux instituteurs, agriculteurs, villageois… le pays a connu en un an deux coups d’État, en janvier et septembre, parce qu’il est reproché aux gens au pouvoir de ne pas arriver à contenir les mouvements djihadistes – ce qui, d’ailleurs, est vrai. Depuis 2015, le nombre d’attaques est exponentiel. En 2018, déjà, j’avais sillonné la ville de Ouagadougou en mobylette et, en passant à la périphérie, il y avait plus d’un million de personnes massées là, qui sont des « déplacés », venant pour la plupart du nord et de l’ouest du pays pour fuir les djihadistes. J’ai été très marqué par ça. Et je parle ici du Burkina mais cela concerne de plus en plus de régions en Afrique.
Dans la pièce, l’absente a vécu et a rencontré des gens vivant en Afrique de l’Ouest francophone : au Mali, au Burkina Faso mais aussi à Niamey au Niger, Cotonou au Bénin. Comment envisages-tu l’espace ?
P. R. : Je pense à Memento Mori [création 2013] ou, plus récemment, à Trois annonciations [création 2020]. Ce sont des pièces qui se passent dans une sorte de chambre noire, où les personnages apparaissent de façon presque fantomatique. Je veux situer Mon absente dans un dispositif similaire. Concrètement, on est dans une chambre mortuaire assez profonde et large, dans une obscurité totale. Au centre, il y a le cercueil avec des gerbes de fleurs, des couleurs. On ne distingue pas l’autour, uniquement les corps qui surgissent de la pénombre. On est comme à l’intérieur d’un ventre, d’une caverne, d’une tête. De ce noir absolu commencent à sortir les paroles et les ectoplasmes visuels des personnages.
Quand mon père est mort, j’ai demandé à rester un moment seul avec lui dans la chambre mortuaire. Mon frère avait le même souhait. Puis d’autres personnes sont entrées, s’approchaient pour parler au mort… Dans Mon absente, je développe cela, je rends audible ce que l’on n’entend pas en temps normal car il s’agit de chuchotements.
Je démultiplie ces propos adressés à l’oreille de la défunte, je les fais flotter dans l’espace. Les phrases se croisent. Et il y a des circulations qui, je l’espère, pourront se faire en temps réel.
Tu veux dire que les interprètes improviseront en quelque sorte les déplacements ?
P. R. : J’ai déjà travaillé comme cela, par exemple pour Répétition [création 2015]. Les endroits du plateau où étaient Stanislas Nordey, Audrey Bonnet, Emmanuelle Béart ou Denis Podalydès étaient différents chaque soir. Je sais que je peux arriver à faire en sorte, dans le travail, que tout puisse être remis en question au jour le jour. J’ai cette confiance car ce sont des actrices et acteurs qui ont un sens de l’espace du plateau, qui peuvent être à un degré de perception du présent et y trouver du plaisir.
Pour écrire le personnage de la défunte ayant des facettes magnifiques et d’autres terrifiantes, t’es-tu inspiré d’une écrivaine réelle – vivante ou morte ?
P. R. : Je n’ai pris personne pour « modèle », mais plusieurs figures m’ont traversé l’esprit. J’ai pensé au rapport de Duras avec sa mère, au destin romanesque et tragique qu’a connu cette mère au Vietnam : j’ai de l’admiration pour son combat, sa volonté de s’en sortir, et on voit en même temps qu’elle était une sorte d’ogresse avec ses enfants.
Je pensais à cette écrivaine sublime que Duras est devenue ensuite, avec une douleur sans fond qui est le terreau de son œuvre. J’ai pensé aussi à Claire Denis, ce qu’elle a pu raconter de son enfance, de son rapport au Cameroun où elle a grandi : elle, petite fille, au milieu des expatriés venus faire du commerce.
Tout cela a orienté ma boussole : je suis parti du Vietnam pour me fixer sur l’Afrique de l’Ouest – avec les mêmes résidus de la colonisation, le rapport aux terres achetées, au commerce. Dans la pièce, l’absente est une écrivaine importante aux yeux des jeunes femmes, pour qui elle a ouvert des pistes notamment en ce qui concerne la condition féminine. J’étais encore en cours d’écriture quand j’ai appris qu’Annie Ernaux avait le prix Nobel. À travers son engagement, elle trouve un écho formidable chez les jeunes générations et notamment les néo-féministes…
L’absente est donc en partie née du mélange de toutes ces figures de femmes qui m’ont traversé. De là est né, dans mon imagination, un personnage totalement contradictoire et qui est vu différemment par chacun des personnages. Vincent, le benjamin, s’est senti aimé, tout comme Audrey, dans une autre mesure. Manifestement, ce sont Stan et Laurent, les deux premiers fils, qui ont morflé. On peut dire que l’absente ne s’est pas occupée de ses enfants mais a été plus aimante avec ses petites-filles. En tout cas, toute sa vie s’est tournée vers la littérature. C’est aussi une question de générations : il y a la vision sombre, pessimiste de Houellebecq sur les femmes des années 60/70 qui ne se sont pas occupés de leurs enfants – parce ce qu’elles voulaient être libres ou pour d’autres raisons – comme sa propre mère, qu’il déteste. En ce qui me concerne, je pense que l’on n’est pas obligés d’être des parents parfaits, toujours disponibles pour ses enfants, toujours aimants.
Depuis plusieurs années, je tourne autour de cette figure ambivalente de la mère – c’était le cas dans Sœurs [création 2018], où les filles jouées par Audrey Bonnet et Marina Hands l’évoquaient, ou même dans Architecture. Pour le moment, elle existe au travers des propos rapportés, des visions des proches. Peut-être écrirais-je un jour pour une actrice qui en deviendra l’incarnation.
Ici aussi, tu utilises le procédé littéraire qui consiste à faire se confronter différents points de vue sur la personne disparue…
P. R. : Quand j’ai écrit Ghosts, qui s’est créé à Taiwan (en 2017), l’idée était la même : reconstituer, dans la mémoire des autres, la présence – ou l’absence – d’une personne, avec toutes les contradictions que cela implique. J’aime l’idée de présenter des personnages dont on pourrait dire que « chacun voit midi à sa porte », qui ne sont pas conscients de leur aveuglement – de ce qui nous paraît évident quand nous sommes en face d’eux dans la salle.
Les samedis, je vais souvent avec mon petit garçon au « Guignol » du jardin du Luxembourg. J’adore ces moments où les enfants crient pour prévenir les personnages que le loup ou le méchant vient de surgir dans leur dos. De la même manière, nous sommes très forts pour voir ce qui ne va pas dans la conduite des autres, alors même qu’on est pour soi-même en plein aveuglement. J’aime jouer sur les différences de point de vue, je l’ai toujours fait – c’est un des fondamentaux du théâtre.
Dans Mon absente, il y a à la fois des adresses à la morte et des échanges. Comme les souvenirs sont tous contradictoires, on est dans la recomposition impossible du souvenir.
Pour moi, cela parle éminemment de ce qu’est la fiction. Lorsque l’on se souvient, on est soi-même, en quelque sorte, un « créateur ». Quand je parle avec ma mère du passé – même de choses banales –, nos souvenirs diffèrent systématiquement. J’aime cet écart.
Parce que dans cet écart, se tient une partie de la création. Se souvenir, c’est une façon de créer.
C’est cela aussi que l’on entend dans Mon absente : les personnages ont refabriqué une histoire personnelle autour de l’absente. C’est en partie l’origine des turbulences en eux et entre eux. Ces turbulences, je les ressens moi-même en écrivant. Il y a ce vent merveilleux de la mer Égée – le meltémi – dont on ressent la puissance quand on fait la traversée en bateau d’une île grecque à une autre. Le meltémi est un bon indice de ce qu’est écrire ! La houle est violente. C’est ce que je ressens en ce moment, en allant d’un texte à un autre.
Il y a ce fantasme de l’écrivain : dilater le temps et faire entendre des pensées. Quand les personnages s’adressent à l’absente, il peut y avoir une bousculade de la pensée, un désordre, des choses qui se superposent et que je prends le temps de « déplier », pour les rendre audibles. J’adore rentrer dans les cerveaux, imaginer ce que les gens pensent.
Toutes ces choses emmagasinées, je les articule dans les fictions. Mes personnages sont des gens qui fonctionnent beaucoup par associations, pensent quelque chose puis disent autre chose à l’autre. Il y a un niveau d’oralité et un niveau de pensées intérieures. Ils ont tous une activité mentale presque frénétique.
Il y a souvent de l’humour dans tes pièces. Qu’en sera-t-il dans Mon absente ?
P. R. : À vrai dire, je ne décide jamais s’il y aura de l’humour ou pas. Je livre des paroles, qui sont interprétées par des gens. En général, je n’ai pas grand-chose à dire aux actrices et acteurs puisque j’ai écrit pour elles et eux. Le texte est une lettre que je leur adresse. Je ne leur dis pas : il faut le dire comme ci ou comme ça. Au contraire, j’attends d’eux qu’ils interprètent ce que j’ai écrit pour eux et, en général, cela me plaît toujours. Je suis le contraire d’un metteur en scène qui a une idée préconçue et dit : ce rôle-là, il faut le jouer de telle manière. Je suis contre ça. C’est ce qui nous oppose d’ailleurs avec Stan ou avec Arthur Nauzyciel – qui sont de grands amis. Ils ont une vision, ils pensent qu’il faut que tel personnage soit comme ça. Moi, je n’ai pas d’idée sur les personnages que j’écris. Quand je les écris pour Stan ou pour Arthur ou Audrey ou Claude Duparfait, ce sont eux qui vont les interpréter. Cela me plaît qu’ils jouent le personnage comme ils ont envie de le jouer. De là peut sortir – comme c’est souvent le cas et alors que je ne l’avais pas prévu – de l’humour. Cela me surprend souvent et j’aime ça. Mais je ne sais pas l’anticiper, encore moins le demander. Mon absente touche à des choses très simples, comme ce que j’ai toujours écrit : la perte d’un être cher, la douleur qui en résulte, l’explosion d’un couple, la fin d’une amitié… Je m’intéresse à ces moments saillants de la vie – ce qui, de mon point de vue, est la chose la plus puissante mais aussi la plus difficile à réussir.
Souvent, les personnages que tu écris sont face à la fin d’une utopie, ou en tout cas une aspiration forte qui s’effondre, une perte ou un échec. Est-ce que la mort de l’absente symbolise quelque chose de cet ordre-là ?
P. R. : Oui, il est fortement question dans la pièce de la mort d’illusions. Comme tu le dis, c’est souvent présent et d’autant plus avec ce que nous sommes en train de vivre : la guerre à nos portes. Il y a un frémissement que j’avais identifié, Architecture finissait par cette phrase : « il va falloir se préparer à des temps auxquels on n’avait pas pensé ». Ce n’était pas à proprement parler le sujet des pièces, mais Architecture comme Répétition pointaient la menace suivante : il devient de plus en plus incertain que l’Europe dans laquelle toi et moi sommes nés en notre temps, va rester l’espace qu’ont construit nos grands-parents, à savoir un espace de paix et de démocratie. Cela m’obsède depuis longtemps. Alors, forcément, j’en rends compte de façon récurrente dans mes pièces. Répétition parlait clairement de la désillusion des utopies socialistes. Dans Architecture, les personnages étaient pris dans un maelström et passaient leur temps à quitter un endroit pour un autre. C’est ce qui se passe aujourd’hui pour bien des gens, dans plusieurs endroits du monde : devoir fuir. C’est terrifiant. Quand je parle avec ma mère, elle me dit que les images qu’elle voit actuellement de l’Ukraine lui rappellent ce qu’elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour les gens de sa génération, quelque chose de traumatique remonte à la surface. Cette guerre nous rappelle la fragilité du monde dans lequel nous vivons. En Europe, nous avons eu la chance de grandir dans du coton – je veux dire, par rapport à des gens qui ont connu la guerre ou la faim ou la dictature. Je n’ose pas m’imaginer devoir partir du jour au lendemain avec un sac à dos – et que mettre dedans ? Sans aller jusque-là, un type comme Zemmour, s’il arrivait au pouvoir, pourrait tout à fait décider de sabrer le budget de la culture… J’ai côtoyé des gens qui se retrouvaient dans des situations terribles. Mes amis Syriens avec qui j’ai créé Gilgamesh en 2000 au Festival d’Avignon se sont tous exilés… Je parle beaucoup de la guerre, plus que de la pièce, mais je ne peux pas ne pas laisser entrer le réel. En tant qu’écrivain, en tant que personne, je ne sais pas faire autrement. Même s’il n’est pas du tout question dans Mon absente de parler de l’Ukraine. Mais ce que j’écris se trouve forcément modifié, cabossé, atteint – comme je le suis.
Entretien réalisé par Fanny Mentré pour le Théâtre National de Strasbourg le 9 mars 2022 et actualisé le 26 janvier 2023
Critiques
 Coups d'Œilpar Samuel Gleyze-Esteban
Coups d'Œilpar Samuel Gleyze-EstebanMon absente, tranches de vie autour d’une morte
On va voir Pascal Rambert comme on attend un dîner de famille : en espérant que des vérités explosent. Mon Absente remet le couvert avec une distribution onze étoiles.
 Le Mondepar Joëlle Gayot
Le Mondepar Joëlle GayotLe chant funèbre pour la littérature de Pascal Rambert
La pièce, servie par d’excellents comédiens, agrège autour de la mort d’une mère les menaces qui pèsent sur l’écriture.
 Un fauteuil pour l'orchestrepar Sylvie Boursier
Un fauteuil pour l'orchestrepar Sylvie BoursierComment se dire adieu ?
Ils entrent et sortent de l’ombre tour à tour, fantômes tristes et sombres au-dessus de l’absente sur son écrin de fleurs.
Recommandation :fff Cult. newspar Amélie Blaustein-Niddam
Cult. newspar Amélie Blaustein-NiddamSeul.e.s face à l’absente de Pascal Rambert
Le maître du langage s’attaque une nouvelle fois à sa double passion : la famille et les mots, dans une pièce majeure où le rôle principal est joué… par une absente. Chef-d’œuvre.
 Scenewebpar Vincent Bouquet
Scenewebpar Vincent BouquetMon absente : les funérailles empruntées de Pascal Rambert
Malgré une distribution quatre étoiles, le dramaturge et metteur en scène peine à donner souffle et consistance à son défilé mortuaire qui, à force de jouer la carte de la théâtralité, en vient à sonner faux.
 Webtheatrepar Véronique Hotte
Webtheatrepar Véronique HotteDire enfin à l’être cher disparu ce qu’on a toujours tu
L’auteur et metteur en scène Pascal Rambert a écrit pour onze acteurs choisis une pièce chorale, sur la présence tendue des membres d’une famille autour du cercueil d’un être cher, leur Mère.
Recommandation :W W W La Terrassepar Louise Chevillard
La Terrassepar Louise ChevillardLa figure de la personne disparue dans une pièce magnifique et bouleversante
Pascal Rambert met en scène son dernier texte, Mon Absente. Il y convoque une personne disparue au cours d’un long, très long tunnel éprouvant, faisant fi des rites traditionnellement conviés par le deuil et la disparition.
Archives des représentations
-
La Criée
|
Marseille
01 févr. > 03 févr. 2024
-
Teatro Storchi
|
Modena
27 janv. > 28 janv. 2024
-
Théâtre National de Nice
|
Nice
23 janv. > 24 janv. 2024
-
MC93
|
Bobigny
12 janv. > 19 janv. 2024
-
Théâtre National de Strasbourg - TNS
|
Strasbourg
29 mars > 05 avr. 2023
-
Châteauvallon - Le Liberté, scène nationale
|
Toulon
23 mars > 25 mars 2023







