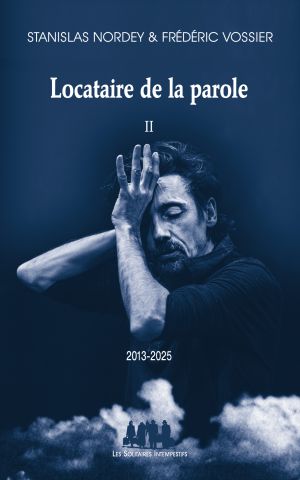

L'Hôtel du Libre-Échange
L’Hôtel du Libre-Échange suit les pérégrinations de deux couples d’amis, les Pinglet et les Paillardin, pris dans une machine théâtrale délirante, dont le carburant est, bien sûr, l’adultère. Adultère d’autant plus incontournable que Monsieur Pinglet et Madame Paillardin ont une sexualité débordante, et leurs conjoints... pas vraiment. À partir de cette donnée de base, les cartes sont rebattues à l’envi par un Feydeau déchaîné, fabricant d’embûches en tout genre. Ce ballet de l’inassouvissement – car coucher ensemble paraît ici relever de l’utopie – emmène dans sa danse un partenaire improbable : un ami de la famille, fraîchement débarqué de Valenciennes avec ses quatre filles tout juste sorties du couvent. L’hôtel de passe où tout ce petit monde finit par aboutir, au milieu d’employés loufoques et de policiers, devient le cadre d’un emballement extravagant, on n’ose dire sans queue ni tête... Plus connu pour sa pratique du répertoire contemporain que pour celle du vaudeville, Stanislas Nordey a pourtant déjà mis en scène Feydeau, avec une Puce à l’oreille hilarante et poétique, dans un décor à la Jarry. Accompagné des mêmes partenaires artistiques, le scénographe Emmanuel Clolus, le chorégraphe Loïc Touzé, et le créateur de costumes Raoul Fernandez, il emmène quatorze acteurs et actrices à travers ce monde bourgeois en folie, et à l’assaut de la langue si particulière du vaudeville.
Entretien avec Stanislas Nordey
Un chant d’amour au théâtre
Même si vous avez mis en scène La Puce à l’oreille il y a une vingtaine d’années, on vous connaît surtout pour vos mises en scène d’auteurs contemporains, pas tellement d’auteurs historiques et encore moins comiques. Pourquoi être revenu à Feydeau et au vaudeville ?
Tout est parti de l’époque de La Puce à l’oreille. J’avais monté beaucoup de textes contemporains, dont plusieurs Pasolini, et je sentais qu’il ne fallait pas que je m’encroûte, j’avais envie de me mettre en danger. J’ai donc lu Feydeau parce que c’était très loin de moi. Loin de la représentation stéréotypée, chargée d’un certain mépris pour le genre, que j’en avais, j’ai découvert un théâtre formidablement bien écrit, tout bêtement. J’ai même eu tant de plaisir à travailler cette langue qu’après avoir terminé La Puce à l’oreille, j’ai tout de suite eu envie de monter L’Hôtel du Libre-Échange (ses grandes pièces sont les plus fascinantes !). Le projet ne s’est pas fait à l’époque pour diverses raisons, et puis en quittant la direction du Théâtre national de Strasbourg, après avoir travaillé les textes passionnants mais, disons, un brin ombrageux de Claudine Galea, Marie NDiaye et Christine Angot, j’ai voulu revenir à ce théâtre de la joie, du vertige, de la sarabande. Ce premier spectacle en tant que compagnie après le TnS est aussi une forme de manifeste en faveur du théâtre à grande échelle dans un contexte où tout est en train de partir à vau-l’eau. Comme un geste de foi dans notre art. Car j’ai reconnu en Feydeau un frère, dans le sens où c’est un amoureux fou du théâtre – des acteurs, des situations, des décors, des costumes, de la mise en scène... Il a une connaissance absolue de l’espace théâtral, et il construit à partir de là quelque chose comme un chant d’amour au théâtre.
On pense souvent à Feydeau comme au dramaturge de la petite bourgeoisie de la Belle Époque. En quoi L’Hôtel du Libre-Échange est-il, comme vous l’avez dit ailleurs, “beaucoup plus qu’un drame bourgeois” ?
Cette représentation classique est pour moi absolument fausse. Si Feydeau est resté alors que plein d’autres vaudevillistes ont été oubliés, c’est qu’il y a chez lui quelque chose qui résiste. Comme Courteline ou Labiche, il exprime une folie profonde. Sourd à l’intérieur de ses textes une angoisse existentielle, qui se manifeste souvent via la sexualité. Pour moi, ses héritiers les plus directs sont des auteurs comme Copi ou Armando Llamas. C’est pourquoi l’un de nos enjeux principaux était de se demander : qu’est-ce qu’on donne à voir et à entendre pour permettre aux spectateurs de ne pas être bordés dans leur réception par une imagerie du début du XXe siècle ? Par ailleurs, je crois aussi que Feydeau est resté parce qu’il maîtrise à la perfection la construction de la narration. Il aurait fait un romancier extraordinaire. Quand on voit la précision, la complexité des intrigues, la manière dont se tissent les histoires, dont elles sont toutes différentes... ! Et puis son théâtre a une vraie langue. Pendant les premières représentations à la Maison de la Culture de Grenoble, on s’est aperçus que le public riait sur la virtuosité du texte, le trait d’écriture, plus que sur telle ou telle blague. Je ne suis pas sûr que, contrairement à ce qu’on croit, le rire soit l’objectif ultime de Feydeau. Le rire est là bien sûr, mais pas seulement. Les enjeux sont multiples. Quelque chose petit à petit se déploie, s’inscrit, dans lequel on se reconnaît. À un endroit ou à un autre, on se reconnaît.
Cet hôtel du “Libre-Échange” est en réalité un hôtel de passe. Le désir – insatisfait – est au cœur de la pièce, il est le point de départ de l’action.
Ce qui est compliqué avec Feydeau, c’est qu’en général la version qui nous est parvenue a été censurée, voire auto-censurée. On l’oublie, mais à cette époque la censure était très présente. Les premières versions contiennent très explicitement des personnages de prostituées, des répliques beaucoup plus crues, et des allusions politiques à l’affaire Dreyfus et au communisme. Mais Feydeau et son co-auteur Maurice Desvallières ont coupé tout cela pour prévenir la censure, ce qui fait que, finalement, il ne reste pas grand-chose de cet “hôtel du libre-échange” dans la pièce. Le désir est là dans l’histoire comme un fil rouge, mais il n’est pas si présent que ça en tant que tel, en tout cas moins que dans d’autres pièces. Néanmoins, il est intéressant de regarder ce que cette question raconte des rapports de genre. Chez Feydeau, le désir le plus présent est le désir masculin, en l’occurrence celui de Benoît Pinglet. La femme dont il veut faire son amante, Marcelle Paillardin, est hésitante dès le départ, et elle le restera. Pourtant, in fine, c’est elle qui mène la danse. Lui est porteur d’une sensualité débordante, mais c’est en même temps un piètre séducteur qui n’a rien d’un Dom Juan et qui s’est fait tout un film dans sa tête. Feydeau, qui était un coureur de jupons, fait là son anti-portrait, et il s’en donne à cœur joie. Et, même si ce serait totalement faux de dire que c’est un auteur féministe, il construit en face des figures féminines fortes. Les porteurs du ridicule sont les hommes, alors que, d’une manière ou d’une autre, Marcelle Paillardin, Angélique Pinglet, la femme de chambre et les filles Mathieu ont un rôle moteur dans les résolutions.
Le théâtre de Feydeau est connu pour son incroyable précision, ses rouages finement imbriqués, qui produisent en même temps une impression de mouvement voire de désordre et de dérèglement. Comment s’empare-t-on de cette mécanique parfaite tout en restant dans quelque chose de vivant ?
Il faut beaucoup de technique, d’autant qu’on a fait le choix, important pour moi, de travailler à voix nue, sans sonorisation. À l’époque, les comédiens étaient spécialisés : comme il y avait les tragédiens, il y avait les acteurs de vaudeville. Aujourd’hui en revanche, on a peu l’habitude de ce type de répertoire, car on monte de plus en plus de formes monologuées, y compris dans les écoles, ce qui génère une certaine difficulté, même pour les très bons acteurs. De plus, quand on plonge dans l’action, qui est le cœur du réacteur de Feydeau, on s’aperçoit que chaque scène ne contient pas une situation mais cinq ou six. Et ces situations se transforment sans cesse, donc on a dû faire un travail extrêmement fin et précis d’identification de tout ce qu’il y avait à jouer. Rien qu’au deuxième acte, il y a 197 entrées et sorties. Concrètement, quand vous êtes metteur en scène, ces 197 entrées et sorties, il faut les régler. C’est terriblement chronophage. J’aime bien la contrainte, mais c’est vrai que Feydeau est assez extrême sur ce plan, parce que son texte est tellement lié à la mise en scène, qu’il a pensée lui même, qu’on ne peut pas s’en écarter. Ça peut être frustrant, mais finalement le fait que le texte fonctionne comme une partition musicale correspond tout à fait à ma façon d’aborder les œuvres en général.
À propos de contrainte, Feydeau décrit très précisément dans son texte l’espace scénique, fournissant quantité de détails, alors que vos spectacles ont tendance à être très dépouillés pour mettre la parole de l’acteur au centre...
Bon, je vais me contredire : en fait ce n’est pas vrai qu’on a besoin de respecter absolument tout ce qui est écrit. Feydeau appartient à un moment particulier de l’histoire du théâtre, il est le contemporain du théâtre libre d’Antoine, des débuts de la mise en scène, de l’arrivée du naturalisme... Il essaie d’être dans l’air du temps avec son luxe de détails, mais en vérité, 54 son théâtre reste un théâtre de la parole. Notre premier travail avec le scénographe Emmanuel Clolus a donc été d’identifier tout ce dont on ne pouvait pas du tout se passer et d’enlever le reste, pour épurer l’espace au maximum. Par exemple, au premier acte, il faut une table d’architecte pour comprendre où on est, une fenêtre et trois portes. On ne peut rien jouer si l’on n’a pas trois portes. Mais c’est tout en réalité.
Dans une note d’intention, vous parlez d’“assumer le divertissement”, et on lit dans l’introduction de l’édition de L’Arche, parue en 2007, que “le rire a le même droit à l’existence que les pleurs”. C’est vrai qu’au théâtre on a parfois tendance à placer le genre comique au bas d’une hiérarchie plus ou moins implicite.
La ligne de fracture entre théâtre public et privé, ou théâtre de boulevard, m’intéresse beaucoup. On dit souvent qu’on va dans le privé pour rire et dans le public pour réfléchir, c’est dommage ! Il est vrai que dans le théâtre d’art ou public, les narrations joyeuses sont plus rares. Ces scènes-là sont plus innervées par Racine ou Claudel que par Molière. Pour avoir beaucoup travaillé avec Falk Richter, qui aime rigoler et qui met toutes sortes de farces dans ses textes, j’ai l’impression que c’est un mal français, comme une sorte de principe de sérieux qui nous serait propre. Il faudrait nuancer ceci dit, puisque Koltès disait que son théâtre devait faire rire, que Beckett se situe entre la comédie et le drame existentiel... Ici, la responsabilité des metteurs et metteuses en scène entre en question. Évidemment, je suis à la fois bien et mal placé pour dire ça, puisque je dis toujours que mon théâtre est un théâtre “de divertissement de la pensée”, et pas de divertissement tout court. Si je suis honnête, ça m’emmène plus loin de travailler sur Le Voyage dans l’Est [de Christine Angot] que sur L’Hôtel du Libre-Échange. Feydeau me fait voyager, me déplacer, mais pas tellement penser. Mais, à côté de ce théâtre d’art – qui me semble fondamental, entendons-nous bien, puisque pour moi le théâtre est avant tout fait pour nous aider à penser –, je trouve qu’il est important de vérifier qu’on sait encore, qu’on peut encore, monter un vaudeville, tout en étant sur une écriture exigeante, de qualité, qui manque parfois dans le privé.
Propos recueillis par Raphaëlle Tchamitchian, le 14 mars 2025
Podcasts
 France culturepar Les Midis de Culture
France culturepar Les Midis de CultureStanislas Nordey fait de la pièce de Feydeau un éloge de la folie
Vingt ans après sa mise en scène de La puce à l’oreille, Stanislas Nordey repart à l’assaut du vaudeville et de Georges Feydeau.
 France interpar Le Masque et la plume
France interpar Le Masque et la plumeUne proposition audacieuse qui divise
Modernité et accessibilité pour certains, contresens et langue phagocytante pour d'autres. Une mise en scène à découvrir à l'Odéon.
Critiques
 Un fauteuil pour l'orchestrepar Denis Sanglard
Un fauteuil pour l'orchestrepar Denis SanglardStanislas Nordey s’attaque pour la seconde fois à Feydeau
Il y a bien quelques sursauts où l’on se dit que oui, là, peut-être, quelque chose advient, mais tout retombe très vite comme un mauvais soufflet.
 Téléramapar Fabienne Pascaud
Téléramapar Fabienne PascaudMauvaise farce en hôtel de passe
Un metteur en scène guère inspiré, une distribution excessive et une scénographie terne… un Feydeau pas au cordeau, à voir à l’Odéon jusqu’au 13 juin.
(abonnés) Scenewebpar Igor Hansen-Løve
Scenewebpar Igor Hansen-LøveNordey en liberté
Vingt ans après La Puce à l’oreille, Stanislas Nordey monte l’autre pièce phare de Georges Feydeau, entouré par la même équipe artistique qu’à l’époque. Une réussite où la folie du jeu et la précision de la mise en scène font bon ménage.
 Le Mondepar Fabienne Darge
Le Mondepar Fabienne DargeStanislas Nordey caracole sur les mots de Feydeau
Le metteur en scène donne à voir un ballet étourdissant et burlesque où le langage se fait révélateur de l’inconscient des personnages.
 La Terrassepar Manuel Piolat Soleymat
La Terrassepar Manuel Piolat SoleymatÀ la lisière du surréalisme
Pieds nickelés des escapades nocturnes et des audaces amoureuses, Monsieur Pinglet et Madame Paillardin entraînent leur entourage dans les dérapages non contrôlés de leurs vicissitudes.
 Libérationpar Sonya Faure
Libérationpar Sonya FaureNordey s’invite à l’hôtel de passe-passe de Feydeau
Stanislas Nordey met en scène «l’Hôtel du Libre-Echange» à la MC2 de Grenoble, avant une longue tournée. Entre technicité affolante et volonté de produire un grand spectacle, le vaudeville devient un manifeste face aux coupes budgétaires qui visent le spectacle vivant.
(abonnés)
Calendrier des représentations
La Filature, Scène nationale de Mulhouse | Mulhouse
Archives des représentations
-
ThéâtredelaCité
|
Toulouse
03 avr. > 11 avr. 2025
-
Malraux - scène nationale Chambéry Savoie
|
Chambéry
27 mars > 28 mars 2025
-
Domaine d'O
|
Montpellier
04 oct. 2025
-
La Criée
|
Marseille
19 déc. 2025
-
Maison de la Culture de Bourges
|
Bourges
05 févr. 2026
-
Théâtre de Lorient - CDN
|
Lorient
21 nov. 2025
-
Le Théâtre - Saint-Nazaire
|
Saint-Nazaire
22 janv. 2026
-
MC2:
|
Grenoble
26 sept. 2025
-
Espace des Arts
|
Chalon-sur-Saône
11 oct. 2025
-
Théâtre de Liège
|
Liège
04 janv. 2026
-
Odéon-Théâtre de l'Europe
|
Paris
31 mai 2025
-
Les Célestins, Théâtre de Lyon
|
Lyon
05 déc. 2025
-
La Coursive
|
La Rochelle
05 févr. 2026
-
Les Gémeaux
|
Sceaux
16 nov. 2025
-
Le Quartz
|
Brest
10 janv. 2026







