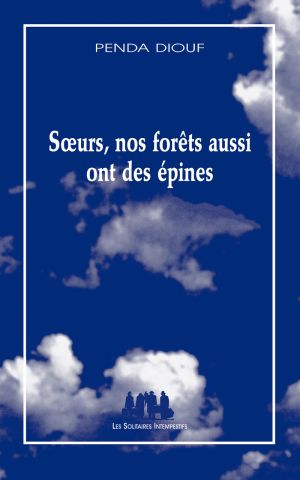

Sœurs, nos forêts aussi ont des épines
Deux sœurs se construisent dans l’ombre d’une mère absente. Un jour, la cadette s’apprête à quitter le nid pour poursuivre ses études ailleurs. Sa sœur tente de la retenir, surviennent alors des réminiscences troubles d’une noyade : est-ce vraiment arrivé ou n’est-ce qu’un mauvais rêve ? Pourquoi revient-il et que signifie-t-il ? Ces femmes nous plongent dans la mécanique de la mémoire, comme on explore les profondeurs marines. A partir de leur relation, elles parlent d’un lien plus large : la sororité des femmes entre elles, un lien complexe, plein de frictions, à la fois vulnérable et puissant. Un lien qui peut engendrer à la fois la compétition et la solidarité.
L'auteure Penda Diouf et la plasticienne et metteuse en scène Silvia Costa mêlent plusieurs dimensions sous nos yeux. Par le truchement d’une histoire familiale, elles explorent plus largement la mémoire et son lien étroit à l’inconscient. Sœur·s, nos forêts aussi ont des épines joue avec les ombres en nous et la matière comme support à quelque chose de plus diffus et peut-être antérieur à notre existence. Une antériorité qu’on aurait dans la peau, imprimée sous les pores, jusque dans nos cellules. Entre réalité, souvenir et projection, les temporalités se croisent et créent un espace polymorphe porté par le symbolisme et la beauté enivrante de l’opéra expérimental.
Penda Diouf et Silvia Costa inventent un véritable langage esthétique empreint de poésie pour créer une œuvre théâtrale s’adaptant à différents espaces.
Notes d'intention par Penda Diouf et Silvia Costa
Elles sont deux. Deux sœurs venant du même ventre. Elles ont partagé cet espace d’habitation temporaire à quelques mois d’intervalle. La mère vivant seule, travaillant beaucoup, l’aînée a toujours pris sa place dans la famille très au sérieux. Il lui a fallu grandir très vite pour prendre le relais à la maison et devenir autonome rapidement. À l’arrivée de sa petite sœur, elle la prend sous son aile et s’occupe d’elle comme une petite maman, comme d’autres jouent à la poupée. Les jours s’écoulent, heureux, dans cette famille à l’allure isocèle. Jusqu’au jour où la plus jeune décide de partir, sortir du cocon pour continuer ses études ailleurs, dans une autre ville. C’est l’heure de quitter la chambre de l’enfance pour remplir les cartons de souvenirs et de se projeter avec enthousiasme dans un ailleurs inconnu. L’aînée est inquiète. Par ses paroles, ses gestes, elle tente inconsciemment de la retenir. C’est alors que les rêves adviennent pour la plus jeune, troublants, récurrents.
Elle raconte. Elles sont petites et jouent toutes les deux sur la plage lorsque la mer l’avale. Sa sœur ne réagit pas. Peut-être même qu’elle la retient sous l’eau.
À partir de ce rêve, souvenir vécu ou fantasmé, le fil de l’existence de ces deux soeurs se délie, se fragmente, avec l’ombre tutélaire de la mère, personnage absent mais fil invisible qui les relie.
D’où vient ce rêve et pourquoi arrive t-il à ce moment précis du départ? Quelle violence cachée révèle t-il? Cette expérience de noyade a t-elle à voir avec une connaissance plus ancienne, lorsqu’elles étaient cellules dans l’espace utérin. Peut-être même s’agit-il d’une époque antérieure, au moment du choix, où l’on décide de sa vie à venir, qu’on écoute les battements du cœur des différentes mères et qu’on choisit celui qui nous convient le mieux, qui bat au diapason avec le sien. Où on décide des batailles qu’il nous faudra affronter et des épreuves qui nous permettront de grandir. Des sœurs qui vont nous accompagner.
Les protagonistes évoluent ainsi dans trois temporalités:
→ Le présent du déménagement et du départ de la benjamine,
→ le temps du rêve lié à l’enfance et à ses traumas, (ces temporalités sont liées et pourront s’entremêler dans l’écriture.)
→ et un temps d’avant la naissance où le rapport à la solidarité et l’amour entre femmes sera plus prégnant, qu’il s’agisse du passage dans le même espace qu’est le ventre maternel à une dimension antérieure encore, où les relations se tissent peut-être par affinités cosmiques.
Ce texte parle de sororité, de souvenirs et de mémoire. Comment la perspective modèle le souvenir et la mémoire qu’il nous en reste?
Mémoire du geste, du corps, mémoire immédiate, mémoire sélective.
Comment l’eau, du liquide amniotique, au corps humain en évoquant la composition de la planète bleue, est récipiendaire de cette mémoire immémoriale.
Penda Diouf, juillet 2023
Ce spectacle parle de deux sœurs. Il naît d’un échange entre deux femmes et de la nécessité partagée d’approfondir le mystère de la relation sororale, qui n’est pas toujours une relation d’union, de support, de soutien, même si le mot “sororité” est entré, de plus en plus fréquemment, dans les discours féministes militants et plus globalement dans les mouvements de solidarité.
L’enjeu esthétique de cette création réside dans le décalage temporel entre un présent concret et une dimension onirique, espace de la mémoire des corps et de leur origine commune.
Basée sur une relation biunivoque où tout est lié, la scène devient cette grotte obscure, où les images apparaissent comme des fantômes de l’expérience passée, de ce qui est remémoré et de ce qui s’est infiltré sous la peau, éparpillé dans les cellules partagées.
Le travail veut donc se concentrer sur ce que les corps peuvent porter - peau, costume, trace - comme les supports d’une installation vivante. Oublier l’espace de la scène pour se perdre dans cette forêt qui est la mémoire. Une mémoire qui bat derrière nous et nous oblige à reconstruire. Des objets incomplets apparaissent comme les marques de cette relation qui nécessite toujours deux parties, en balance, unies, l’une à l’autre.
Pour traverser les trois différentes temporalités évoquées par Penda Diouf - réalité, rêve, origine - la musique est une alliée fondamentale et permettra d’entrer dans différentes dimensions sensorielles. À cette fin, nous avons imaginé une collaboration avec le collectif italien Tutto Questo Sentire (TQS), fondé par Sandro Mussida et par deux sœurs - comme les protagonistes du spectacle - Rebecca et Olivia Salvadori. La pluridisciplinarité est à la base de leur travail, qui combine le son, la voix et les images vidéo. TQS fonde son travail sur les études de l’oto-rhino-laryngologiste français Alfred Tomatis, qui lient le développement de l’écoute au développement de soi. Ce développement commence dès la présence dans le ventre de la mère avec l’écoute de la voix des parents, ce qui influence la venue au monde et la personnalité. Le collectif créera une partition sonore et vocale qui permettra de rêver ce monde de l’intérieur, des origines. Les images projetées de Rebecca Salvadori serviront de pont pour nous permettre de quitter la scène et nous immerger dans une nuit utérine.
Silvia Costa, août 2023
Entretien croisé
Comment cette collaboration est-elle née et où vos univers artistiques respectifs se sont-ils rejoints pour donner naissance à ce projet commun?
PENDA DIOUF : Silvia et moi sommes toutes les deux membres de l’Ensemble artistique à La Comédie de Valence. Mais nous n’avions jamais vraiment eu l’occasion d’échanger. C’est Claire Roussarie, directrice adjointe de La Comédie de Valence, qui m’a proposé de travailler à un texte pour Silvia et j’ai tout de suite accepté car j’étais curieuse de son univers. Silvia m’a donc donné rendez- vous avant le spectacle Trois annonciations de Pascal Rambert, dans lequel elle jouait. Elle m’a raconté avoir envie de parler de sororité. C’était, pour elle, un idéal à atteindre mais la société ne favorisait pas la solidarité entre femmes. Et puis Silvia m’a raconté un rêve où elle se promenait dans la forêt et tout à coup, sa sœur est apparue, cachée dans un arbre. Je lui ai demandé si elle pouvait me faire un dessin de cette rencontre. C’est ainsi que la collaboration a commencé.
SILVIA COSTA : La rencontre avec Penda a été dès la première fois très inspirante. J’ai senti une connexion et une compréhension qui m’ont menée à partager avec elle mes expériences de collaboration entre femmes, parfois complexes, ou celle que j’ai vécue personnellement avec ma sœur… J’ai senti qu’avec elle je pouvais trouver une forme poétique et narrative pour raconter, en la questionnant, la sororité, terme qui n’existe pas encore véritablement dans le vocabulaire commun.
Dans cette histoire, la relation entre les deux sœurs oscille entre amour, solidarité et tension. Comment explorez-vous cette dualité, à la fois dans l’écriture et dans la mise en scène?
PENDA DIOUF : Je souhaitais aborder la complexité de la relation sororale. On peut être de la même famille et ne pas du tout s’entendre, avoir des caractères diamétralement opposés. La place dans la famille joue également, si on est l’ainée ou la cadette. J’avais envie de suivre ces sœurs à un moment précis: une balade en forêt juste avant le départ de la cadette à l’étranger. L’occasion de remettre leur relation au cœur, de lever les non-dits et de poser les questions. De tout remettre à plat pour une nouvelle naissance dans la façon de faire relation.
SILVIA COSTA : Dans nos premières discussions, on a souvent évoqué la création de dimensions différentes pendant le spectacle, une au présent, concrète, réaliste, une deuxième altérée comme dans un rêve, où des souvenirs surgissent comme un flux de conscience, et une troisième qui parle d’universel, qui comme un cri d’appel ou une formule magique puisse rassembler toutes les femmes, une sororité qui transcende le sang. J’ai donc cherché à mettre en valeur ce changement d’état avec les différentes scènes, en marquant leur division. J’ai cherché un caractère pour chacune qui puisse guider le spectateur dans ce voyage textuel, riche en images, en informations, en connexions entre éléments mais aussi en émotions. Et puis surtout j’ai cherché un équilibre entre texte et symbole, geste et parole, information et image, en montrant une divergence entre ce que l’on entend et ce que l’on voit. L’eau revient souvent dans le texte (liquide amniotique, noyade, composition de la planète).
Quel rôle joue cet élément dans le lien entre les deux sœurs?
PENDA DIOUF : Je pense à une citation de la philosophe Simone Weil “Aimons cette distance qui est profondément tissée d’amitié, car ceux qui ne s’aiment pas ne sont pas séparés”. L’eau est l’élément de la distance: la mère et l’enfant à naître, les plaques continentales sur la planète. Mais c’est aussi un élément qui porte une mémoire. Le corps est composé à 70% d’eau. Comment cette énergie émotionnelle peut-elle influer sur les personnages? Comment, à son contact, les souvenirs des deux sœurs sont réactivés, retraversés pour être mis à plat et peut-être trouver des réponses ainsi qu’une forme d’apaisement.
Podcasts
 France culturepar Le Book Club
France culturepar Le Book ClubRetracer les mémoires, avec Penda Diouf
Aujourd’hui, gros plan sur un théâtre éminemment contemporain. La dramaturge et metteuse en scène Penda Diouf tisse une œuvre faite d’histoires minorées, dans des textes troublants et avec une grande sensibilité. Alors que deux de ses pièces sont montées en cette rentrée, elle est notre invitée.
 Icipar Le choix d'ici en Drôme Ardèche
Icipar Le choix d'ici en Drôme ArdècheThéâtre en mouvement : Silvia Costa et Penda Diouf explorent les liens de la sororité
Diplômée en arts visuels et théâtre, Silvia Costa présente sa dernière création, Sœurs, nos forêts aussi ont des épines, une pièce itinérante en collaboration avec l'autrice Penda Diouf.
Critiques
 Mouvementpar Adèle Beyrand
Mouvementpar Adèle BeyrandPenda Diouf & Silvia Costa : Sœurs contre méchant loup
Faire du conte une odyssée féministe ? Tel est le pari de la metteuse en scène Silvia Costa et de l’autrice Penda Diouf avec Sœur·s, nos forêts aussi ont des épines : une ode à la sororité pavée de tableaux futuristes et de tirades énigmatiques. Du Petit Chaperon rouge au militantisme il n’y a qu’un pas.
 Scenewebpar Fanny Imbert
Scenewebpar Fanny ImbertLe voyage en sororité de Silvia Costa
La metteuse en scène et scénographe italienne Silvia Costa s’empare du texte de l’autrice Penda Diouf et signe avec Sœur·s, nos forêts aussi ont des épines un voyage visuel qui n’oublie pas d’être sensible.
Recommandation :Coup de cœur Balaganpar Jean-Pierre Thibaudat
Balaganpar Jean-Pierre ThibaudatLa sororité au village
Penda Diouf et Silvia Costa signent « Soeur.s, nos forêts aussi ont des épines », nouveau spectacle itinérant de la Comédie de Valence, Centre Dramatique National de Drôme-Ardèche. Une belle histoire de femmes.
Archives des représentations
-
MC93
|
Bobigny
05 févr. > 15 févr. 2025
-
Théâtre Varia
|
Bruxelles
24 janv. > 30 janv. 2025
-
La Comédie de Valence
|
Valence
07 janv. > 16 janv. 2025







